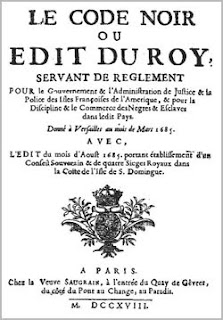Top 10 de mes souvenirs de Syrie
Votre mission pour ce 10 août, si vous l’acceptez, vaillants Mondoblogueurs, est de rédiger un top 10 sur le sujet de votre choix. Défi relevé, Ziad!
La Syrie m’habite. La Syrie me hante. Depuis mon trop court voyage dans ce pays peu connu aux portes de l’Europe, je n’en suis pas complètement revenu. La beauté stupéfiante de ses cités millénaires, le doux vacarme de ses souks odorants, l’effroyable tintamarre de ses rues où des automobiles de fabrication chinoise ou iranienne se disputent le pavé, la gentillesse de ses habitants, leurs sourires radieux assenés sans gêne aux visiteurs étrangers presque agressés par tant d’amabilité… En ce temps-là, en novembre 2010, le « printemps arabe » n’avait pas commencé, et personne ne l’avait vu venir. Les dictatures arabes apparaissaient au faîte de leur stabilité. C’était une autre époque, où la Syrie coulait des jours heureux, ou son quotidien ne se résumait pas à une litanie de tragédies. Qu’est devenue la Syrie? Qu’est-il advenu de mes amis? Autrefois, tout était différent. Il y avait une vie avant la guerre.
Voici dix images, dix souvenirs d’autrefois, de ce pays martyr qui, je l’espère, saura sauver son âme de cet effroyable conflit qui n’en finit plus.

1. « Welcome to Syria! »
Au bout d’une heure de voyage, après que le taxi syrien qui m’emmenait de Trablous, dans le nord du Liban, à la grande ville côtière de Lattaquié, a passé l’impressionnant poste frontière, une fois réglées les formalités administratives, les trois passagers syriens m’ont enfin adressé la parole. « Welcome to Syria! », se sont-il exclamés, surmontant pour la première fois la barrière de la langue pour m’inclure dans la conversation qui jusqu’ici s’était déroulée en arabe. « Welcome to Syria », répètent-ils, encore et encore. Ce n’était que le début. Combien de fois ai-je entendu cette phrase tout au long de mon séjour? Vingt fois par jour? Quarante fois? Dans la rue, des inconnus se retournaient sur mon passage, me tapaient sur l’épaule, m’attrapaient le bras, se détournaient de leur chemin pour venir à ma rencontre, juste pour me souhaiter la bienvenue dans leur pays, et disparaître dans l’anonymat de la foule. « Welcome, welcome ». Je n’ai jamais connu quelque chose de semblable ailleurs.

Une de ces anecdotes qui m’ont le plus marqué, c’est la rencontre avec ce jeune père et sa femme, dans une ruelle de la vieille ville de Hama. Après l’habituel « welcome to Syria » et quelques questions plus ou moins indiscrètes pour s’enquérir de mon pedigree, mon interlocuteur se lance sans raison apparente dans un monologue enfiévré où il m’explique comment son épouse ici présente et lui ont failli se séparer après cinq ans de mariage, jusqu’au jour où est née leur adorable fillette qu’il porte présentement sur ses épaules. Depuis, ils sont à nouveau une famille heureuse. L’épouse se tient a distance et ne semble pas comprendre assez bien l’anglais pour participer à la conversation. Étrange rencontre. Mais il semblerait qu’en Syrie, n’importe quel prétexte est suffisant pour échanger quelques mots avec le visiteur étranger.
2. L’hospitalité syrienne
Revenons à mon petit taxi syrien qui effectuait la liaison Trablous-Lattaquié. Nous avons passé la frontière libano-syrienne et faisons une courte halte à un petit café sans prétention au bord de la route, aux environs de Tartous, surplombée par un château du temps des Croisades. Les passagers syriens m’offrent le café. Je proteste. C’est très gentil, chers amis, mais mon café, je peux me le payer. Que nenni. Vos protestations n’y changeront rien. Quand un Syrien a résolu de vous inviter (et cela arrive incroyablement souvent), alors il le fera, que vous le vouliez ou non. Vous êtes un visiteur dans son pays, et c’est son « devoir » de faire preuve d’hospitalité.

Dans ce pays presque mythologique qu’est la Syrie d’avant-guerre, le visiteur étranger devait s’attendre à recevoir des invitations en permanence: à boire le café, à se faire payer son repas par ses nouveaux « amis » qu’il connaît depuis une demi-heure à peine, à se faire payer l’entrée des musées et des sites archéologiques… et tout ceci de manière entièrement désintéressée. C’est fou. C’est unique au monde. C’est l’hospitalité syrienne.
3. La citadelle d’Alep
Juchée pesamment au sommet d’une colline aride qui surplombe la ville, entourée d’une profonde tranchée circulaire où s’accumulent les détritus, la citadelle médiévale construite aux XIIème et XIIIème siècles par les défenseurs musulmans de la ville pour la protéger des invasions des Croisés est l’un des symboles les plus visibles d’Alep, capitale économique et plus grande ville de la Syrie d’avant-guerre. Elle était bien sûr ouverte au public, et offrait aux visiteurs, en plus d’une vue imprenable sur la grande métropole cinq fois millénaire, une grand amphithéâtre taillé dans le roc et une « salle du trône » d’époque mamelouke, luxueusement décorée en boiseries de cèdre.

Que reste-t-il d’Alep? De sa vieille ville, classée au Patrimoine mondial de l’UNESCO? De son souk, le plus grand et le plus animé du pays, si ce n’est de toute la région? De son industrie du savon à l’huile d’olive et au laurier, réputée dans tout le monde arabe et bien au-delà? De ses mosquées vieilles de plus de mille ans? De sa fière citadelle qui a traversé les siècles? De ses habitants?
4. Les trois mousquetaires de Lattaquié
Je les nomme ainsi, mais en réalité, ils s’appelaient Fater, Mohammed et Khaled, et gravitaient autour de l’hôtel Al-Fateh, une petite auberge très bon marché, presque sordide, où j’ai atterri par hasard à Lattaquié, après avoir cherché en vain mon « funduq » (hôtel) qui manifestement n’existait plus. Fater était un pensionnaire à long terme de la maison Al-Fateh, jeune chirurgien cardiologue de son état originaire de Damas, Mohammed, le fils du patron, étudiant en « mécatronique » à l’université de Lattaquié et son cousin Khaled, étudiant en droit qui préparait alors le TOEFL.

Après une petite promenade à pied dans les rues de la ville et notamment le long de la côte, le trio m’a emmené en voiture, moi qui n’avais rien demandé, pour une longue virée à la plage puis dans les restaurants bon marché et sympathiques de la ville. Conformément aux règles de l’hospitalité syrienne, ils ont absolument tout payé et catégoriquement refusé que je participe de quelque manière que ce soit. C’est difficile à comprendre, mais j’étais leur « invité », leur « ami » et c’est donc ainsi. Il était hors de question que je débourse la moindre livre syrienne. Je me suis senti quelque peu submergé par tant de générosité. Plus tard, rentré à l’hôtel, les Syriens n’ont pas arrêté de me servir à boire : de l’eau, du café, du thé. Du café très fort, même à minuit. Et de la bière sans alcool. Gratuitement, cela va sans dire.
Mais les choses ne se sont pas arrêtées là. Lorsqu’ils ont compris que mon intention était de visiter « al Qala’at Salaheddine », le Château de Saladin, l’une des attractions de la région dans l’arrière-pays de Lattaquié, ils m’ont tout de suite promis qu’ils m’y emmèneraient le lendemain. Le lendemain à l’heure dite, ils étaient à nouveau là tous les trois. Fater avait décidé pour l’occasion que le CHU de Lattaquié pourrait bien se passer de son chirurgien cardiologue ce mardi-là, car il avait des choses plus importantes à faire: m’emmener au château avec ses amis. Les trois mousquetaires m’ont conduit au château, puis ils ont, une fois de plus, refusé que je paye mon billet d’entrée, un geste d’autant plus étonnant que mon billet coûtait cinq fois le prix du leur (30 livres syriennes pour eux, 150 pour moi, c’est-à-dire trois dollars US)… Mais il n’y avait pas moyen de leur faire entendre raison. Nous avons donc visité le château, qui constitue une agréable promenade verte et historique dans les montagnes de la région. Sur place, nous avons rencontré un touriste anglais solitaire. Tout de suite, les Syriens ont compris qu’ils pourraient lui faciliter les choses en l’emmenant à la gare à 15 heures pour qu’il prenne son train pour Alep. Branle-bas de combat, hop, on repart avec l’Anglais, on l’emmène à l’hôtel pour un thé, on partage avec lui nos mandarines et nos gâteaux, les Syriens nous offrent des paquets de tisane locale pour l’occasion, puis tout le monde se retrouve à la gare. Nos amis Syriens ont réglé les formalités assez longues et compliquées pour l’achat des billets de train (que nous avons cette fois payés nous mêmes, enfin). Dans la gare, des gens me voyant avec mon sac à dos disaient « Welcome to Syria ». Après une quantité assez incompréhensible de démarches, où même les passeports se sont avérés nécessaires (plusieurs fois), nous avons obtenu nos billets de train. Sans nos amis syriens, nous n’y serions probablement pas parvenus. Après avoir fait tant pour nous, ils nous ont accompagnés sur le quai pour nous dire au revoir. En fait, en Syrie, il y a une culture de l’hospitalité qui dépasse tout ce qu’on imagine.

Je me suis fait trois amis à Lattaquié. Que sont-ils devenus? Comment survivent-ils dans l’horreur de la guerre? À en juger par les mises à jour de son profil Facebook (un site « interdit » dans la Syrie d’Assad), l’un des trois mousquetaires de Lattaquié me semble avoir « mal tourné ». Sur ses nouvelles photos, il arbore désormais une longue barbe et une mine patibulaire. Rien à voir avec le jeune homme avenant et rieur que j’ai connu il y a trois ans. Mais qui d’entre nous ne tournerait pas « mal » après des années de guerre, lorsque tout s’écroule autour de soi?
5. La mosquée omeyyade de Damas
À Damas, je ne me suis pas vraiment fait d’ami, à part peut-être Hasan, le serveur kurde d’un café de Bab Touma où je me suis rafraîchi un après-midi. Mais qu’à cela ne tienne, le Damas d’avant-guerre avait tant à offrir au visiteur: des palais et jardins ottomans, une vieille ville dont les origines remontent à plus de cinq mille ans et où l’on s’amuse à se perdre, des hamams millénaires eux aussi, un et surtout, la grande mosquée omeyyade, construite au VIIIème siècle, soit tout de même 400 ans avant Notre-Dame de Paris.

L’immense construction en pierre s’ouvre sur une vaste cour intérieure, tout en marbre, où l’on déambule sans ses chaussures, laissées préalablement à l’entrée du bâtiment. Mais qui a besoin de ses chaussures pour fouler un sol si lisse, si propre? Les balayeurs sont toujours là, à l’affut de la moindre feuille de peuplier qui s’égarerait dans cet espace sacré et presque aseptisé. En Syrie, chacun peut venir visiter la mosquée à sa guise, qu’il soit musulman ou pas. Même pendant la prière du vendredi, la visite continue. La mosquée est un lieu de vie ouvert à tous. J’ai passé des heures dans cet endroit unique, assis à même le sol en marbre, à observer les familles, les touristes, les fidèles allant et venant, à lire, à écouter l’appel du muezzin, à me gorger de cette atmosphère si apaisante…
La mosquée omeyyade de Damas a presque 1400 ans d’histoire, et a survécu à nombre de catastrophes, d’incendies, de tremblements de terre, et même aux Mongols. Dans quel état la retrouverons-nous, quand cette sale guerre sera terminée?
6. Prendre le thé chez les Bédouins à Palmyre
Certes, il existe bien un endroit en Syrie où le touriste est un pigeon en puissance, où les vertus nationales de gentillesse et d’hospitalité désintéressées n’ont plus cours, où tous les escrocs du pays se sont donné rendez-vous, prêts à fondre sur leurs victimes rendues insouciantes par cette étonnante tradition de générosité envers le visiteur étranger: Palmyre, l’antique capitale de la reine Zénobie, qui jadis défia la puissance de Rome. Situées à côté d’une oasis aux portes du désert, à mi-chemin entre Damas et la vallée de l’Euphrate, les ruines époustouflantes de la cité antique constituaient un passage obligé pour chaque touriste en Syrie.

Mais Tadmor, le Palmyre moderne, à côté du site archéologique, ne survit (ne survivait) que des revenus du tourisme, et le visiteur étranger se sentait très vite, dès la descente du bus, harcelé par toutes sortes de personnes: des chauffeurs de taxi, des cafetiers, des vendeurs de souvenirs, des rabatteurs en tout genre… À Tadmor-Palmyre, on n’est plus un noble étranger qui mérite tous les égards, on devient une proie, à plumer au plus vite. Lorsque, au détour d’un mausolée antique à moitié écroulé, des Bédouins convient le touriste assoiffé que vous êtes à prendre le thé chez eux, il vous faut désormais vous attendre à offrir un « bakchiche » (cadeau) à votre hôte et à ses enfants, sinon, gare! Et ils savent vous forcer la main pour que vous leur ouvriez votre portefeuille. Après plusieurs jours passés en Syrie, on a le temps de s’habituer à la générosité désintéressée des Syriens, et le choc est d’autant plus rude. Mais dans le fond, ce n’était pas bien grave, c’était une expérience déplaisante, mais intéressante à vivre parmi de pauvres hères qui survivaient comme ils le pouvaient dans leur oasis paumée.
Maintenant que les touristes ont déserté pour de bon les ruines de Palmyre, de quoi vivent les Bédouins de Tadmor?
7. Promenade à Hama avec Moayad et ses amis
À mi-chemin entre Alep et Damas, la ville de Hama est surtout connue pour ses gigantesques norias en bois actionnées depuis 2000 ans par les eaux brunes et paresseuses du fleuve Oronte (et pour les massacres perpétrés sur ordre de Hafez el Assad dans les années 1980, mais ça c’est une autre histoire). Dans le bus qui m’y emmenait d’Alep, j’ai fait la connaissance de Moayad, un étudiant alépin qui venait rendre visite à sa famille. Il a échangé exprès son siège dans le bus avec un passager pour pouvoir s’asseoir à côté de moi et faire un brin de causette pendant les deux heures de route, malgré son anglais plutôt hésitant. J’apprends entre autre qu’il est fiancé à une jeune chrétienne qui étudie avec lui à Alep.

Hama est une ville provinciale plutôt agréable. J’y fais l’expérience de me faire coiffer et raser par un vrai barbier oriental, pour un prix imbattable. Le soir, je retrouve Moayad, et deux ou trois de ses amis. L’un d’entre eux, je me rappelle, ne parle pas un mot d’anglais, mais semble se plaire à être là avec nous. Nous déambulons ensemble dans la douceur du soir. Mes nouveaux amis me décrivent les bâtiments que nous passons, des écoles, des églises, des mosquées. Des familles flânent sous la garde attentive des pères ou des oncles. L’air est saturé d’odeurs de gâteaux et de sucreries. Bien entendu, on me paye absolument tout et on me refuse le droit de mettre la main au portefeuille. Moayad m’étonne lorsqu’il me déclare qu’il ne fume pas car « son Président dit que c’est mauvais pour la santé ». Vu le nombre de fumeurs que j’ai vus absolument partout en Syrie, il semblerait que le message de santé publique du président Assad avait du mal à passer auprès de la population. À moins qu’il ne s’agisse d’une forme de rébellion latente contre l’autorité du despote aux yeux bleus…
Qu’est-il advenu de mon ami Moayad et de sa fiancée chrétienne? Ont-ils pu terminer leurs études à Alep? Se sont-ils mariés? Ou leurs vies sont-elles irrémédiablement endeuillées?
8. Real ou Barça?
Lorsque l’on visite un pays pour la première fois, on y découvre forcément un certain nombre de choses auxquelles on ne s’attendait absolument pas. La plus grande des surprises que m’ait réservée la Syrie est sans conteste la passion maladive des Syriens pour le football européen. D’autant plus que cette nation arabe, à seulement quatre heures d’avion de Berlin, et à une heure de vol de Chypre, tourne ostensiblement le dos à l’Europe (et à l’Occident en général): dans les rues, le voyageur occidental ne reconnaît quasiment aucune enseigne familière. Les voitures sont iraniennes, indiennes ou chinoises. Les investisseurs viennent de Turquie ou des pays du Golfe, à en juger par les panneaux à l’entrée des centres commerciaux dernier cri. Pour le Syrien moyen, l’Europe n’existe donc que par le foot! Ainsi, lorsqu’un Syrien s’est lié d’amitié avec vous (un processus qui dure environ une dizaine de minutes), il osera enfin poser les questions qui lui brûlent les lèvres depuis le début.

« Tu es français? Quel est ton club préféré dans le championnat français? Moi je préfère Marseille, mais j’aime bien Rennes aussi. » (oui, j’ai vraiment entendu ça en Syrie).
« Tu vis à Berlin? Mais c’est super ça. J’adore la Bundesliga. Je suis un fan du Bayern. Et toi? »
Et la question la plus importante d’entre toutes: « Tu supportes le Real ou le Barça? ll y a un Clásico dans trois semaines. On le regarde ensemble? »

Dans la Syrie en guerre, peut-on encore suivre la Liga Española et la Champions’ League? Peut-on encore le passionner pour le foot lorsque tout s’écroule autour de soi?
9. Entendre parler l’araméen par un native speaker à Maaloula
« Vous parlez vraiment l’araméen? Pouvez-vous me dire quelques mots? »
La commerçante, visiblement habituée à entendre cette requête, s’exécute de bonne grâce, et prononce des paroles inintelligibles, des sons affreusement gutturaux, d’atroces râclements de gorge, des grognements de pourceau à l’agonie. J’en ai même pris quelques notes. Mo’ishmakh veut dire « bonjour », et Ekhtshob, « comment allez-vous ». C’est beau comme un disque de Marilyn Manson. À l’envers.
Enfer et damnation ! La langue maternelle de Jésus était-elle vraiment si râpeuse à l’oreille? Satisfait d’avoir entendu quelques mots d’araméen comme promis par mon Lonely Planet, mais sidéré par ses sonorités rocailleuses, je prends congé de la libraire et poursuis ma visite du village, les oreilles encore tout écorchées par les borborygmes caverneux tout droit venus, paraît-il, du Nouveau Testament.

Dans les montagnes et les vallées aux alentours de Damas, il existe des villages peu arabisés où les habitants parlent encore aujourd’hui un dialecte d’araméen réputé très proche de la langue que parlaient Jésus et ses contemporains. Maaloula est le plus grand et le plus connu de ses villages, et est aisément accessible en minibus depuis la capitale, à 50 kilomètres de là. Nichée à flanc de montagne, dans la chaîne de l’Anti-Liban, la bourgade chrétienne offre au visiteur un beau panorama sur le massif montagneux ainsi qu’une forte concentration d’églises et de monastères grecs orthodoxes, assortis de tout un tas de légendes plus ou moins invraisemblables. Que sont devenus les villageois de Maaloula? La guerre les a-t-elle rattrapés eux aussi, dans leurs vallées isolées?
10. Le regard de Bachar
La Syrie « heureuse » d’avant-guerre était bien sûr une dictature, gouvernée d’une main de fer pendant quatre décennies par un même clan familial sans aucune assise démocratique ni la moindre légitimité populaire, les Assad. Mais à mon grand étonnement, la politique était loin d’être un sujet tabou dans la Syrie de cet automne 2010, moins de deux mois avant le début du Printemps arabe. J’ai été surpris par le nombre de fois où des Syriens m’ont demandé, sans passer par quatre chemins, ce que je pensais de leur pays ou de leur Président, ou du voisin israélien. Souvent pris de court, je me suis généralement contenté de réponses prudentes, diplomatiques, évasives, pour éviter les frictions et les chausses-trapes de ce terrain tout à fait inconnu et potentiellement miné où je ne tenais pas à m’embourber. Après tout, où que je dirige mon regard, je croisais toujours celui de Bachar : dans la Syrie d’avant le conflit, où que vous soyez, il y avait toujours un portrait du Président dans votre champ de vision, vous défiant presque de soutenir son regard.

Bon sang, il est partout ce Bachar ! Le poing levé façon « ¡Viva la revolución! » par ici, Bachar portant des Ray-Ban par là, Bachar l’air grave et visionnaire, Bachar souriant sur un arrière-plan en forme de cœur, Bachar en écusson brodé sur les uniformes des garde-frontière, Bachar (ou son père Hafez) sur les billets de banque… Toujours ce même regard bleu, glacial, scrutateur. Bachar, Bachar, Bachar. Bachar et Hafez. Hafez et Bachar. C’est l’indigestion de Bachar. Que les Syriens n’en puissent plus, cela peut aisément se comprendre. Mais
Voilà mon top 10 de moments passés en Syrie. Voyager, c’est avant tout rencontrer une autre culture, un autre peuple, d’autres visages. Ce sont surtout ces personnes que j’ai croisées sur mon chemin qui ont fait de la Syrie une destination complètement à part, de tout ceux que j’ai entrepris jusqu’ici. Le meilleur de la Syrie, ce sont vraiment ses habitants. Aucun peuple ne mérite de subir la guerre. Mais s’il y en a un qui le mérite encore moins que les autres, c’est bien le peuple syrien. Courage dans vos épreuves, mes amis! Un jour, la paix reviendra, et moi aussi, inch’Allah, je reviendrai en Syrie.